
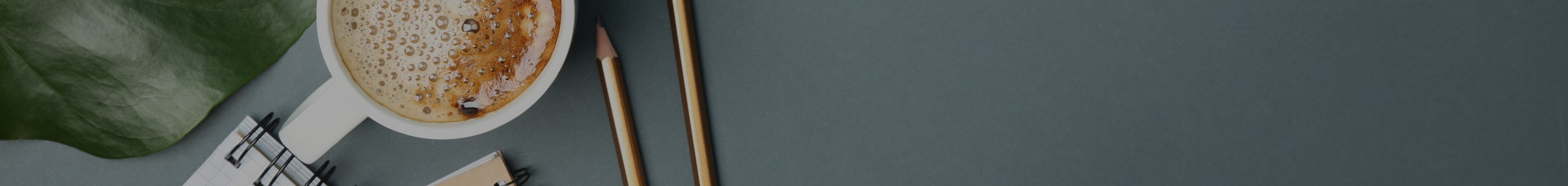

Les albums qui ont marqué leur époque, tant par leur musique que par le charisme d'une pochette bien sentie ne manquent pas, et les tops les recensant non plus. Les internets pullulent de listing interminables et arbitraires, trustés – sans doute à raison - par Beatles, Pink Floyd et autres œuvres rock'n'roll de Warhol (cf. Sticky Fingers des Stones, et le premier album parfait du Velvet). C'est pourquoi nous allons nous efforcer de faire court – quatre albums et deux mentions honorables – et peut-être (un tout petit peu) plus original, sans tomber dans les profondeurs musicales interlopes, rassurez-vous. L'occasion au passage de faire la lumière sur le travail des artistes et photographes à qui l'on doit ces images cultes. Voici donc notre top des albums (vinyle) que l'on a autant envie d'écouter que de placarder au mur.
1. Joy Division – Unknown Pleasures, 1979 - Peter Saville
Premier album de la formation rock fétiche des broyeurs de noir assermentés, Unknown Pleasure distille les 10 titres qui vont entamer la légende lugubre de Joy Division. Un mythe que la pochette minimaliste et ténébreuse créée par Peter Saville – graphiste attitré et co-fondateur du label culte Factory Records – va tout simplement rendre intemporel. Un design simplissime, furieusement transposable sur une foultitude de surfaces, du coton des tee-shirts du groupe à l'épiderme des fans les plus dévots, inspiré par une image que Bernard Sumner, guitariste du groupe, avait dégotée dans l'édition 1977 de la Cambridge Encyclopaedia of Science.
Intitulée « 100 consecutive pulses from the pulsar CP 1919 », elle représente les ondes du premier pulsar - une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même - découvert en 1967 par l'astrophysicienne Jocelyn Bell - qui sera, soit dit en passant, évincée du Prix Nobel de physique décerné pour cette découverte en 1974... à son patron - de sexe masculin, bien évidemment. Lorsque ladite étoile tourne, elle émet un rayonnement électromagnétique, sous forme de faisceau, que les radiotélescopes peuvent capter. Chaque ligne de l'image correspond à une impulsion individuelle, dont la longueur varie en fonction de la distance parcourue par les ondes et des obstacles rencontrés en chemin. Vous suivez ?
Un schéma scientifique sibyllin pour le commun des mortels, mais très beau, de l'aveu même de son auteur original, Harold D. Craft Jr, un doctorant qui les avait publiés dans sa thèse de 1970, « Observations radio des profils d'impulsions et mesures de dispersion de douze pulsars ». L'étudiant avait élaboré à l'époque « un programme qui, au lieu de représenter chaque ligne verticalement, les inclinait légèrement afin de donner l'impression de regarder une colline, ce qui était esthétiquement plus agréable » (sic). Saville choisit – contre l'avis du groupe - d'inverser les couleurs du dessin original, trouvant la version noire « plus sexy et moins cheap » (sic) et de faire l'impasse sur toute forme de texte : ni le nom du groupe, ni le titre de l'album ne figurent sur le design original de 79. Une prise de risque mercatique devenu coup de génie indéniable. On est (post)punk ou on ne l'est pas que voulez-vous.
> du même artiste et tout aussi culte : New Order – Power, Corruptions and Lies, 1983
2. Patti Smith – Horses, 1975 - Robert Mappelthorpe
New York, mitan des seventies. Lorsque la jeune Patti Smith s'adosse au mur de l'appartement immaculé du richissime amant actuel du photographe Robert Mappelthorpe, elle ne s'imagine probablement pas qu'elle s’apprête à révolutionner la vie de générations entières de jeunes filles rebelles. Derrière la caméra donc, c'est son âme sœur, celui avec qui elle a partagé une vie mi-bohème mi-destroy dans une chambre miteuse du Chelsea Hotel pendant dix ans. La gueule d'ange qu'elle a croisée le jour même de son arrivée à NYC dans une librairie de la Cinquième Avenue. Le coup de foudre. C'est lui qui l'a encouragé à devenir la poétesse punk – le terme n'existe même pas encore - qu'elle est aujourd'hui. Avec lui, elle a toujours pu être elle-même. Et c'est d'autant plus vrai le jour de cette séance photo séminale presque improvisée. « Porte une chemise propre ! » Patti s’exécute, dégote ladite chemise blanche aux puces, et débarque chez son ex amoureux avec ce look et cette attitude androgynes qui vont faire d'elle une icône.
Patti Smith & Robert Mappelthorpe
Crinière emmêlée, menton fièrement levé, et veste négligemment jetée sur son épaule comme l'aurait fait Frankie Sinatra : elle en jette. Il faut dire qu'il fallait au moins ça à Horses, premier album artsy et incandescent produit par John Cale (oui, le John Cale du Velvet Underground) aux Electric Lady Studios de New York (oui, les studios de Jimi Hendrix). Huit flashes plus tard, c'est dans la boîte, l'histoire du rock ouvre un nouveau chapitre. Le punk du Bowery naissant a trouvé son égérie féminine.
3. David Bowie – « Heroes », 1977 - Masayoshi Sukita
1976. David Bowie, rincé par une vie de débauche californienne où il s'est adonné à une cocaïnomanie acharnée, décide de s'exiler quelque temps à Berlin pour se refaire une petite santé. Il y invite son ami et muse du moment, Iggy Pop, et en profite pour conceptualiser une flopée d'albums mythiques : « Heroes » (deuxième opus de la fameuse trilogie berlinoise de Bowie... et le seul réellement enregistré à Berlin), mais également The Idiot et Lust For Life – premiers albums solo d'un Iggy post-Stooges. Installés à Schöneberg, les deux compères trouvent notamment l'inspiration dans le musée voisin, le Brücke-Museum. C'est là qu'ils tomberont en amour devant le tableau expressionniste « Roquairol » (1917) d'Erich Heckel : le portrait un brin flippant de l'artiste Ernst Ludwig Kirchner, alors en pleine dépression nerveuse.
Roquairol, Erich Heckel, 1917
Lorsqu'il sera temps de prendre la pose pour illustrer les pochettes d'« Heroes » et The Idiot, chacun rejouera à sa manière la posture bizarroïde dudit Roquairol devant l'objectif inspiré du photographe nippon Masayoshi Sukita - habitué des coulisses des tournées de Bowie. Si Iggy mime de manière assez littérale la dégaine exagérée de Kirchner, Bowie, lui, insuffle à son affectation un sous-texte personnel délicat. Il s'est reconnu dans la tension introspective du tableau, l'émotion brute figée dans les traits anguleux de Roquairol. En se mettant dans sa peau, David Bowie symbolise sa renaissance après les tourments. L’apaisement après les turbulences. La guérison après le chaos. La sobriété : l'acte héroïque rock'n'roll ultime.
> du même artiste et tout aussi culte : Iggy Pop - The Idiot, 1977
4. Sonic Youth – GOO, 1990 – Raymond Pettibon
En voilà une pochette d'album qui cumule les références pop culture...en tous genres. Lorsque Sonic Youth doit donner suite à l'excellent Daydream Nation, la formation musicale phare du noise rock, désormais signée sur une major, se doit d'assurer. Le groupe, jamais là où on l'attend, sollicite notamment Chuck D de Public Enemy - une hérésie à l'époque - brisant le cou aux supposées incompatibilités d'humeur entre rockeurs et rappeurs. En résulte un tube proto rap noisy Kool Thing, première véritable incursion de Sonic Youth du coté de la musique mainstream. Mais GOO ne s'est pas contenté de faire secouer à la jeunesse bientôt grunge son cuir chevelu cracra avec virulence, il a aussi fortement marqué ses rétines.
Kim Gordon, la bassiste/it girl rebelle de Sonic Youth n'a qu'un nom en tête pour la conception de la pochette de GOO : Raymond Pettibon. Artiste indie über cool, Pettibon, de son vrai nom Raymond Ginn, est accessoirement l'ex membre fondateur du groupe punk hardcore culte Black Flag. Devenu depuis une star de l'art contemporain grâce à ses dessins cyniques typés BD, il produira sans le savoir l'une des pochettes les plus sérigraphiées de l'histoire du rock alternatif. Un soir de désœuvrement, il attrape un exemplaire du magazine True Detective et gribouille distraitement un dessin en s'inspirant d'une photo de tabloïd anglais des sixties qui illustre un article qu'il ne se donne même pas la peine de lire. Il faut bien l'avouer, le résultat est très cool.
Maureen Hindley & David Smiths
Sauf que l'article en question traite d'un fait divers britannique effroyable qui a faite date : The Moors Murders. Le cliché qui a inspiré Pettibon est une photo volée par un paparazzo à la sortie d'un tribunal. Les protagonistes de la photo est le couple aussi cool que maudit Maureen Hindley et David Smiths. Certes très photogéniques, les deux jeunes gens ont également été mêlés (malgré eux) au procès british le plus médiatique et glauque des années 60 : celui des tueurs en série Myra Hindley et Ian Brady. Un couple tout droit sorti des enfers, responsable du meurtre de plusieurs enfants et de la dissimulation de leurs dépouilles dans la lande mancunienne de Saddleworth : difficile de faire plus diabolique.
Myra Hindley & Ian Brady a.k.a The Moors Murderers
Si nous passerons les détails scabreux de cette affaire, c'est pour mieux nous recentrer sur les muses du dessin de Pettibon. Maureen était la sœur de Myra Hindley. Sa moitié, David Smiths, s'était attiré les faveurs du terrible Brady, qui avait décidé, allez savoir pourquoi, de le faire participer à l'ultime exaction du couple. C'est lui qui alertera la police après avoir été témoin d'un acte innommable alors qu'il avait été invité à boire un verre chez son ami le sociopathe et sa chère et tendre. Maureen et David ne s'en remettront jamais, et mèneront – assez logiquement - une existence très tourmentée après cet épisode.
Quant à Sonic Youth, ils n'avaient jamais eu vent de cette histoire avant le dessin de Pettibon : “Nous ne connaissions pas tout le contexte de cette photo, mais dès qu’on l’a vue, nous avons été subjugués par la force de l’image”. Et de toute évidence, ils n'auront pas été les seuls.